La crise actuelle, sanitaire puis économique, sera assurément un accélérateur de résilience pour nos systèmes industriels et productifs. Elle nous a, notamment, rappelé l’importance de pouvoir ou de savoir produire localement, rapidement et en quantité suffisante une grande variété de biens qui sont essentiels à notre quotidien. Sur les masques, les gels, les visières ou les respirateurs, on a vu que l’enjeu n’était pas seulement de relocaliser pour répondre à la demande locale : il s’agit aussi de faire preuve d’agilité, quand l’offre locale vient à manquer, pour faire des « sauts productifs » et produire de nouveaux biens à partir des mêmes matières premières, des mêmes procédés ou des mêmes savoir-faire – grâce à l’ingéniosité des entreprises et à leur capacité à mettre en œuvre de nouvelles alliances parfois contre-nature (par exemple de grands industriels et des makers dans le cas du respirateur Mak-Air à Nantes). Dans tous les cas, la relocalisation industrielle et les circuits courts alimentaires sortent d’ailleurs en tête des attentes des Français pour « le monde d’après » – attentes auxquelles les marques et enseignes devront très vite répondre pour fidéliser leurs clients ou en conquérir de nouveaux.
A l’instar de la crise de 2008, le contexte actuel démonte le mythe d’une économie sans usine et fait fortement émerger les enjeux de relocalisation, de ré-industrialisation. Il pointe également les fragilités de notre modèle agricole. Il montre à quel point il est urgent de rapprocher les lieux de production et de consommation, de mieux distribuer l’économie et la production sur nos territoires, de repenser la fabrication dans les villes, de décentraliser les échanges. L’idée n’est pas de parvenir à l’auto-suffisance ou d’atteindre 100% de production locale mais de rechercher un minimum d’offre et de diversité productive pour pouvoir faire face aux aléas naturels ou climatiques (dont on sait que leur probabilité de survenance va augmenter dans les prochaines décennies) et à leurs répercussions économiques (pénuries notamment).

Mais concrètement, comment améliorer la résilience productive de nos territoires ? Pour y parvenir il va falloir considérablement diversifier nos économies, imaginer des sites de production locaux ou hyper locaux en complément, voire en redondance avec la supply chain mondialisée. Il va falloir atomiser les lieux de production classiques et savoir profiter des innovations en cours (robotisation, automatisation, digital) pour rendre ces productions locales plus accessibles et rentables.
Quelle posture pour les grandes enseignes face à ce défi ?
Traditionnellement la défense du made in local ou du made in France dans la distribution passe par deux leviers : l’un lié aux achats (soutien à des filières, chartes et engagements, alliances locales, politique d’achats en direct, MDD régionales, …) et l’autre lié au marketing ou au merchandising (mise en avant des offres locales ou nationales à travers des labels et certifications, étiquetage on pack comme le Franco-Score d’Intermarché, stop rayon, linéaires dédiés, événements promotionnels, théâtralisation, …). Cette double approche, notamment dans l’alimentaire, a permis d’accompagner voire d’éduquer les consommateurs. Mais elle ne suffira pas.
Aujourd’hui il existe trois limites à la résilience productive : l’insuffisance de producteurs locaux (les faire émerger ou faciliter leur essor est essentiel), l’insuffisance de plateformes ou de tiers de confiance qui organisent les échanges (ce que les collectivités locales notamment ont mis en place pendant le confinement avec les plateformes de mise en relation des agriculteurs et consommateurs) et, enfin, l’absence d’acteur de la filière qui prenne véritablement le leadership sur cette économie distribuée (on renvoie souvent la balle aux élus qui eux-mêmes regrettent de ne pas assez travailler avec les entreprises…).

Dans ce contexte, la plupart des enseignes pourraient légitimement avancer que la partie production n’est pas leur métier. Cependant, et sans aller jusqu’à fabriquer elles-mêmes les produits vendus (ce que font tout de même plusieurs enseignes alimentaires et non alimentaires), les distributeurs pourraient exploiter les nombreuses opportunités de cette économie distribuée, de nouveaux modèles d’affaires et de revenus reposant sur la capacité à organiser la production (en réseau) et à la rapprocher des consommateurs.
Parmi les solutions porteuses d’opportunités pour la distribution, plusieurs se distinguent :
- Les « Contract Manufacturing Network », des réseaux de micro-producteurs sous contrat (ou en coopérative) fonctionnant avec une plateforme de mise en relation des clients avec la micro-usine et les fabricants les plus proches pour fabriquer le produit sélectionné (comme sur les meubles ou le textile). Un bon exemple est fourni par la plateforme Opendesk, qui vend du mobilier de bureau conçu par elle et réalisé par un artisan ou un fablab près de chez vous.
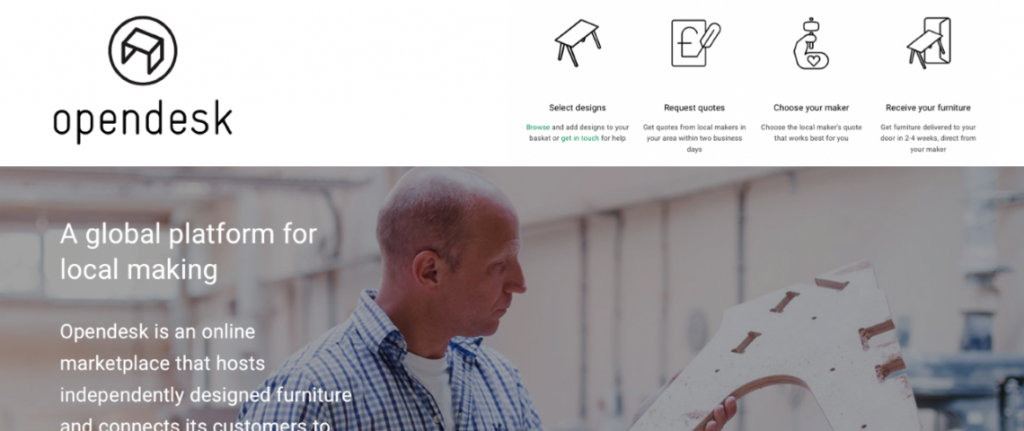
- Les solutions « Plug & Play », des solutions modulaires (en containers ou en kit) ou mobiles (usine mobile ou camions) qui viennent se greffer sur une exploitation agricole ou un site industriel, avec un modèle de revenus qui peut varier (location du matériel, partenariat commercial, pourcentage sur les ventes,..). Il existe des dizaines d’exemples comme les abattoirs mobiles ou les solutions d’emballages allant de ferme en ferme ; ou encore les procédés industriels qui permettent la diversification des agriculteurs sur des produits transformés à plus forte valeur ajoutée (par exemple les laboratoires pour transformer le lait en yaourts, glaces ou beurre) que les enseignes pourraient ensuite distribuer localement. Un exemple récent est celui de la nouvelle marque de glaces La Mémère (lancée par Arnaud Montebourg), 100% bio et fabriquées chez le paysan en circuit ultra-court grâce à un atelier de transformation installé dans un conteneur recyclé.

- Les « Production Franchise Network », qui sont des réseaux de micro-producteurs en franchise : l’idée pour l’enseigne (ou la marque-enseigne) serait de proposer une marque ombrelle et des solutions commerciales ou logistiques à de petits producteurs souvent coupés des grands circuits de distribution, dans l’esprit de ce que propose la start-up Tout Près d’Ici.
- Le modèle de « collaborative Cloud Manufacturing » qui consiste en une plateforme de fabrication ouverte / collaborative permettant une production plus rapide et personnalisée combinant un processus de co-création pour le design et de micro-usine pour la production, comme récemment pour les visières destinées aux personnels soignants fabriquées dans des centaines de fablabs répartis sur le territoire, ou comme le fabricant automobile Local Motors.
- Le modèle de « FabShop » qui consiste à imaginer, dans le magasin ou à proximité immédiate des espaces « agricoles », un atelier de production, de transformation voire de personnalisation des produits : agriculture urbaine / vertical farming, incubateur alimentaire / foodlab, speedfactories (personnalisation de produits textiles ou chaussures), espaces de prototypage (petites séries) ou encore toutes les applications concrètes de « lean manufacturing » au niveau local (absence de stock et duplication). Quelques exemples sont fournis par la micro-brasserie locale installée par Whole Foods dans son magasin de Houston, par les ateliers de réparation/customisation ouverts par Patagonia et même H&M dans certains de leurs magasins.
- L’économie circulaire intégrée à la logique des magasins : récupération et transformation in situ des invendus du magasin, système de livraison avec consigne opéré par le magasin ou un site internet, laboratoires de réparation et /ou de recyclage (recyclage plastique à proximité immédiate des magasins avec des solutions en containers)
- Ou encore les nombreuses applications digitales qui fleurissent aujourd’hui et visent à hacker le rôle des enseignes et dont la distribution pourrait tirer bénéfice si elle se positionnait habilement. A titre d’exemple, les plateformes qui visent à créer un lien direct entre les agriculteurs et les consommateurs avec le concept de « micro-field renting » : l’agriculteur peut décider de partitionner un ou plusieurs de ses champs en de petites unités agricoles, chaque consommateur loue un micro-champ sur la plateforme et l’agriculteur s’occupe de le cultiver pour lui…
Ces exemples l’illustrent : la résilience productive constitue un formidable terrain de jeu pour changer le monde… et une incroyable opportunité pour les enseignes de mettre à profit le contexte actuel pour s’adapter à une économie et à des modes de fabrication probablement de plus en plus distribués et complexes à organiser. La grande distribution, notamment, pourrait y gagner un meilleur ancrage sur les territoires, une plus grande proximité avec ses clients et une utilité sociétale réactivée… en plus d’un vertueux et nécessaire renouvellement de son modèle vers une consommation plus locale et porteuse de sens. Une occasion rêvée de vérifier la pertinence de cette citation de Richard Branson « chaque entreprise a le potentiel de changer le monde et ne survivra pas si elle ne le fait pas ».







