Urbaniste né en Colombie à la fin des années 1950 et arrivé en France en 1979, Carlos Moreno est un expert reconnu des problématiques de la ville et des questions relatives à la ville dite “intelligente”. En 2015, à l'occasion de la COP21, il introduit le concept de “la ville du quart d'heure”, qui s'appuie sur un meilleur maillage des services au niveau local. L'objectif ? Repenser l’organisation de la ville pour contribuer à la réduction de l'empreinte carbone des grandes agglomérations.
Pour ce faire, l’urbaniste s’inspire de l’architecte Le Corbusier, et de la façon dont il a pensé la ville indienne de Chandigarh, construite en 1947, après l’indépendance du pays. Dans cette utopie architecturale, chaque centre administratif, chaque école, chaque bureau de poste, chaque commerce et chaque temple est accessible à pied en moins de 10 minutes. Une nouvelle façon d'aménager l’espace qui invente un modèle urbain fondé sur les courtes distances, plus sobre et plus résilient.
Ces dernières années, un nombre croissant de métropoles et de mégapoles à travers le monde, de Paris à Ottawa en passant par Melbourne, Portland ou encore Milan, ont choisi d'adopter les principes de transformation urbaine mis au point par Carlos Moreno. En misant sur la réhabilitation des friches, la non-artificialisation des sols, la plurifonctionnalité des bâtiments, et l'immobilier mixte, ces municipalités tentent de s'adapter aux défis climatiques.
Entretien avec celui dont les idées font bouger l’aménagement de nos villes.
Quels sont les principaux atouts de la ville du quart d'heure ?
Carlos Moreno : C'est un concept qui vise à changer nos modes de vie urbains et territoriaux. Nous voulons transformer la ville pour la rendre polycentrique. L'objectif est de créer de nouvelles polarités grâce à une répartition plus équitable des services dans les territoires, ce qui doit permettre de sortir d'un modèle qui favorise les déplacements sur de longues distances, avec pour corollaire le recours au véhicule thermique pour une grande partie des citadins. Pour ce faire, nous voulons développer la polyfonctionnalité des bâtiments pour qu'ils puissent accueillir plusieurs activités en les rendant modulaires, réversibles, multi-usages. C'est un atout pour raccourcir les temps de transport car cela permet de rapprocher les services des habitants.
La ville du quart d'heure vise à impulser une révolution des mentalités pour mettre fin à la mobilité contrainte et tendre vers une mobilité choisie et bas carbone, à pied ou en vélo, sur de courtes distances. Aller où l'on veut quand on veut, sans aucune obligation, en renforçant l'accessibilité à des activités de proximité.
Ce changement produit un impact écologique positif car le raccourcissement des trajets permet de réduire la pollution qui en découle. Par ailleurs, la ville du quart d'heure permet également de stimuler l'économie locale grâce à l'implantation de nouveaux business models, filières courtes, réindustrialisation, relocalisation d'activités… Elle favorise le brassage social, synonyme d'une plus grande mixité des populations, car le logement est plus facilement accessible sur l'ensemble des territoires. Enfin, elle signifie plus d'espaces publics pour les citadins et moins pour les voitures.
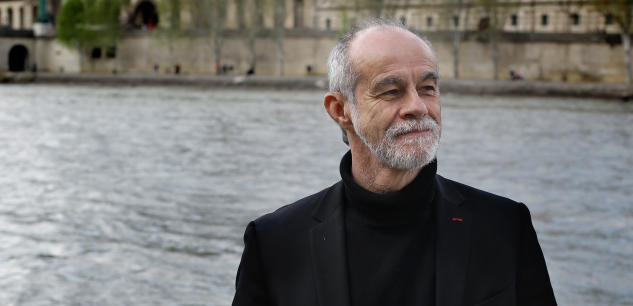
Pour lutter contre l'étalement urbain, les objectifs de zéro artificialisation nette prennent actuellement de plus en plus d'importance dans les plans locaux d'urbanisme. Comment cette mise à l'arrêt progressive de l'expansion des métropoles entre-t-elle en résonance avec le principe de ville du quart d'heure ?
C.M. : La question tient moins dans la fin de l'expansion des métropoles que dans le modèle de vie urbaine que l'on veut avoir. Ne plus artificialiser implique de repenser la manière de façonner la ville, mais aussi d'y vivre. C'est un véritable changement de paradigme. Depuis la Charte d'Athènes, c'est-à-dire depuis 90 ans, les villes se sont développées en fonction d' un acte constructif qui consistait à aller toujours plus loin et toujours plus vite. Cette impulsion a donné lieu à une importante croissance urbaine. C'est ce qui a fait qu'à l'intérieur des métropoles, la pression foncière s'est progressivement accrue jusqu'à devenir insoutenable, tandis que dans les banlieues, on continuait de construire à bas prix. Il s'agit donc de changer cette façon de faire pour aller vers un meilleur aménagement de la vie citadine. Cet enjeu n'a jamais fait l'objet de beaucoup d'attention de la part des urbanistes et des municipalités qui ont préféré concentrer leurs efforts sur la fabrication de la ville. C'est ce que l'on est en train de payer très cher avec la crise des banlieues et des quartiers sensibles. Les émeutes récentes sont en partie dues à ces actes constructifs mal pensés, réalisés avec des matériaux de mauvaise qualité, dans des zones d'habitation dépourvues de services, pénalisées par un déficit de transports et par des équipements en nombre insuffisants pour les populations qui y vivent… Pour réaménager la vie urbaine, il faut réutiliser l'existant, désartificialiser les friches, développer le multi-usages.
Rappelons qu'aujourd'hui, un bâtiment n'est occupé en moyenne que 40 % du temps. Parce qu'il est mono-usage, il est fermé 60 % du temps. Cela veut dire que nous disposons d'un indice de réaménagement qui est absolument phénoménal. Regardez ce qui a été fait à Paris avec la réhabilitation du quartier Clichy-Batignolles… Il y avait une ancienne friche ferroviaire qui a été transformée en parc urbain, avec la création de presque 4 000 logements, dont la moitié sont des logements sociaux et 25 % sont en accession à la propriété. Ce projet prouve à lui seul qu'il est possible de faire autrement.
Est-ce que cette nouvelle façon d'aménager implique que les rares espaces disponibles en ville vont devenir encore plus recherchés ?
C.M. : Oui, c'est certain. Et c'est une question très importante. L'espace en ville est si rare que la recherche des friches urbaines est désormais guidée par une démarche structurée. C'est pour ça que le rôle de la ville en tant qu'aménageur est crucial. Il faut que les municipalités réinvestisent le rôle stratégique qu'elles ont à jouer dans les politiques d'aménagement territoriale car si l'espace en ville est devenu rare, c'est aussi le cas pour plusieurs autres ressources vitales, que ce soit l'eau, le temps utile, l'air pur, l'énergie, et même le silence ! Le XXIᵉ siècle sera marqué par une bataille pour retrouver tout cela. C'est pour cette raison que les Plans Locaux d'Urbanisme sont plus que jamais à l'ordre du jour. Le succès mondial de la ville du quart d'heure tient d'ailleurs à cela. Nous avons défini des indicateurs de haute qualité de vie urbaine, en prenant en compte les fonctions sociales essentielles à chaque individu... Le logement, le travail, l'alimentation, la santé, la culture et les loisirs.... Et ces fonctions sociales peuvent être déclinées en services, en usages et en infrastructures au sein des territoires, avec à la clé une meilleure gestion du temps et le tissage de nouveaux liens économiques et sociaux autour d'une écologie positive.

Pour arriver à cette transformation de fond, l'avenir est-il à une meilleure collaboration entre les acteurs de la ville, municipalités, entreprises du bâtiment, architectes, urbanistes, start-ups, bailleurs, syndics... ? Chacun ayant tendance à opérer dans son coin...
C.M. : Assurément. Et il ne faut pas oublier le rôle très important que peut jouer l'État. Ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a une réelle fragmentation des acteurs, avec pour conséquence un manque de stratégie globale. On le voit avec la difficulté des métropoles à produire des plans d'aménagement qui répondent aux enjeux du XXIᵉ siècle. Il faut davantage de dialogue et de coopération. A ce titre, le Plan Local d'Urbanisme bioclimatique, qui a été voté par le Conseil de Paris, a été élaboré dans une démarche de consultation et d'inclusion. Ce que je souhaite, c'est que les villes s'emparent pleinement de ces transformations en mettant l'Etat dans la boucle. Il y a des difficultés structurelles, mais il faut les surmonter pour aller vers ce type de programmatique. Il faut pouvoir adresser toutes les questions relatives au climat, à la biodiversité, à la rareté des espaces et des ressources, et il faut pouvoir en débattre.
Qui s'inscrit dans cette démarche collaborative aujourd'hui ?
C.M. : Valérie Pécresse a pris une initiative courageuse en lançant un projet qui vise à faire de l'Ile-de-France un territoire des proximités, avec la création de 32 nouvelles centralités et de 102 nouvelles polarités. Le but est d'arriver à rendre tous les services accessibles en moins de vingt minutes. Ce projet est consultable sur le site internet de la région. Il a été pensé pour être ouvert à la discussion. J'invite toutes les parties prenantes à participer à ce débat parce qu'il est structurant. Chacun peut apporter des idées et réfléchir à des solutions.
Quelles autres évolutions seraient souhaitables dans un avenir proche ?
C.M. : Outre tout ce que l'on peut observer aujourd'hui, la relocalisation de l'emploi doit être prise en considération. C'est la première préoccupation des gens. Il faut redynamiser l'activité économique dans les grandes villes. Il faut aussi un programme de logements à bas prix qui doit être incarné dans une politique de mixité sociale. Le logement accessible continue à être pointé du doigt alors qu'il devait être considéré comme le principal générateur des interactions physiques et du mélange des populations. Enfin, et je le répète, il faut que toutes ces transformations soient davantage portées par l'État. La ville et le logement doivent devenir des causes nationales.






