Pouvez-vous nous rappeler le spectre des activités de la Macif et ses chiffres-clés ?
La Macif est un groupe d'assurances mutualiste, nous déployons nos activités de protection dans une dimension solidaire depuis 60 ans. Aujourd'hui, nous sommes plus de 10.000 salariés et représentons 5,5 millions de sociétaires – en tant que mutuelle, nous ne parlons pas de clients, mais de sociétaires qui ont un rôle dans une gouvernance représentative.
La Macif est un acteur majeur du secteur, avec 6,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui se répartissent entre l'assurance dommages, l'assurance santé prévoyance et l'assurance-vie. Nous sommes également la première société d'assurance automobile en France en nombre de contrats avec plus de 6 millions de véhicules assurés en 2019.

En tant qu’assureur mutualiste, sans actionnaire à rémunérer, nous réinvestissons tous nos résultats au service de nos sociétaires. Cela comprend la mise en place de dispositifs de solidarité pour nos sociétaires et la société. Nous faisons également partie des acteurs les plus en pointe en matière d’investissements répondant aux critères ESG (ndlr : environnementaux, sociaux et de gouvernance).
Grâce à notre modèle de gouvernance démocratique et représentatif que font vivre nos 1390 délégués élus par les sociétaires, nous menons chaque année près de 3 600 actions d'intérêt général (de prévention, d’actions solidaires de sensibilisation…) dans toute la France. C'est un élément constitutif de notre identité.
Comment vos sociétaires ont-ils été affectés par la crise que nous venons de vivre ? Comment votre groupe s’est-il organisé pour faire face ?
Notre souci premier a été de protéger nos salariés tout en assurant une continuité de service pour nos sociétaires. Cela s’est traduit par la mise en place du télétravail et de la réassurance via le maintien de l'emploi et des salaires, sans recours au chômage partiel. Avec nos sociétaires, nous avons également maintenu le lien et même au-delà. Nous avons renforcé nos dispositifs solidaires, pour les adapter aux besoins les plus urgents et offrir à nos sociétaires un secours exceptionnel face à des difficultés qui ne sont pas forcément couvertes par leurs contrats.
Entre les mesures extracontractuelles pour soutenir nos sociétaires et les mesures solidaires d'accompagnement de partenaires associatifs ou des personnels soignants, ce sont près de 110 millions d’euros d’efforts financiers cumulés.
En cohérence avec notre raison d’être « protéger le présent et permettre l’avenir », nous souhaitons participer à notre niveau, à la relance sociale et économique du pays. Depuis mi-juin, nous déployons ainsi différentes mesures en soutien du pouvoir d'achat, ou de publics plus fragilisés. C’est d’ailleurs le sens de notre nouveau dispositif global de solidarité : Macif Solidarité Coups durs permet à tout sociétaire de la Macif, d'avoir gratuitement accès à un accompagnement social, s’il rencontre des difficultés.
À votre sens, comment les évènements des derniers mois vont-ils bousculer le secteur ? Comment les assureurs peuvent-ils agir, notamment à l’aune des grands défis de l’époque, et des risques émergents (risques climatiques, sanitaires, cyber, etc.) ?
Ce que je crois, c’est que l'assurance est un métier d'avenir. Parce que chacun dans sa vie sera confronté à des besoins de protection croissants. Face à des tendances de long terme comme l’allongement de la durée de la vie, mais aussi aux nouveaux risques, l'assurance sera de plus en plus sollicitée. C’est presque paradoxal au sortir d’une crise où l'assurance a été assez éreintée, comme n'étant pas au rendez-vous pour certaines professions – je pense notamment aux restaurateurs. Mais c’est l’occasion d’aligner les discours et les faits sur le rôle social de l’assurance.

Après la protection des risques, nous agissons aussi en finançant la transition écologique et la remise en proximité de l’économie. Le secteur de l’assurance, à lui seul, place chaque année 1 600 milliards d’euros ! À la Macif, nous adressons et soutenons des pans de transition écologique ou des projets à forte utilité sociale, par exemple à travers notre filiale de gestion d’actifs OFI.
Autre levier qui caractérise les mutuelles comme la nôtre, le soutien du développement économique, et notamment celui de l'économie sociale et solidaire. L’ESS représente 10% de l’activité économique en France. C’est un réel vecteur d'emplois, de richesse et de solidarité. La Macif en est un partenaire historique et nous renforçons cette présence avec la création d'un fonds d’accompagnement et de financement dédié aux structures de l’ESS avec le fonds Macif Impact ESS.
Concernant les nouveaux risques – pandémies, risques cyber, catastrophes environnementales, etc. – il faudra les aborder selon trois dimensions. L’intervention en direct des assureurs bien sûr, mais ces risques sont si systémiques qu'ils doivent aussi intégrer une part de couverture construite avec les pouvoirs publics. Enfin, nous aurons un rôle prépondérant à jouer en matière de prévention.
Être mutualiste, concrètement, qu’est-ce que ça change dans la façon de pratiquer le métier d’assureur ? Vous parliez à l’instant de plus d'accessibilité, plus d'inclusion ? Comment cela se traduit-il au quotidien ?
Demain, les citoyens français auront besoin de plus de protection. Et ils seront attentifs à ce que cette protection ne soit pas réservée à quelques-uns, mais qu’elle soit collective, inclusive et solidaire.
La différence mutualiste part de quelque chose de très important : son système de gouvernance original qui associe les représentants de la société civile. Dans une mutuelle, ce ne sont pas des actionnaires financiers qui sont au conseil d'administration, mais les représentants des sociétaires. Ils sont issus de la société civile, des mouvements associatifs, syndicaux, des mouvements professionnels. Et ça change beaucoup de choses. Quand je porte un projet devant le conseil d'administration, la première question qu’on me pose, ce n’est pas « combien ça rapporte ? » mais « à quel besoin ça répond ? »
Cela a un impact direct sur notre métier, à plusieurs niveaux. Premièrement, nous construisons nos garanties pour les rendre accessibles au plus grand nombre : on segmente peu, on construit nos offres pour que l’essentiel des Français puissent y accéder. Cela se voit aussi dans la mutualisation des tarifs. Dit autrement, nous faisons en sorte que les bons risques aident à alléger la cotisation de certains « moins bons » risques, dans une juste mesure ; mais nous incitons chacun à avoir des comportements responsables, dans l’intérêt de la communauté des sociétaires.
Cela se traduit également dans la relation avec nos sociétaires. Elle est directe, non intermédiée, elle n’est pas « polluée » par des enjeux de rémunération à la commission. Pour un salarié de la Macif, l’enjeu n’est pas le montant de la cotisation, mais sa capacité à bien servir le sociétaire avec de bons contrats.

La différence mutualiste, c’est aussi l’appartenance à un collectif attaché aux mêmes valeurs de solidarité et d’entraide permettant de faire naître des dispositifs solidaires hors assurances que j’évoquais tout à l’heure. C’est notre « dividende mutualiste » : ce qu'on ne donne pas à nos actionnaires – puisqu'on n'en a pas – on le consacre en large partie à soutenir des causes à forts enjeux sociaux. Cette année par exemple, nous fêtons les 20 ans de la Prestation Solidarité Chômage, un dispositif unique (nous sommes le premier et seul assureur en France à le proposer) et qui permet aux sociétaires en situation de perte d’emploi de continuer à se protéger.
Ce qu'on ne donne pas à nos actionnaires – puisqu'on n'en a pas – on le consacre en large partie à soutenir des causes à forts enjeux sociaux : c'est cela, le dividende mutualiste.
Nous mettons l'accent sur trois engagements : la jeunesse, les publics vulnérables et l'environnement. Nous mobilisons un certain nombre de leviers, notamment notre fondation d'entreprise, et les actions de terrain réalisées par nos délégués qui touchent chaque année entre 100 et 150 000 sociétaires.
Comment les entreprises peuvent-elles être actrices du changement ? Comment intégrer un impact positif dans le modèle d'affaires ? Quel doit être le rôle de l’entreprise dans la société ?
Pour moi, imaginer que l’entreprise serait un îlot de prospérité au milieu d'une société qui subirait des évolutions, des transformations ou des drames, est une idée totalement obsolète.
Ce questionnement n’est pas nouveau, il date presque de la création même de la forme d’entreprise moderne au 19ème siècle ! Sans remonter aussi loin, on convoque à intervalle régulier l’entreprise pour s’engager : à l’image de la vague du développement durable dans les années 80, puis la vague RSE au tournant des années 2000. Aujourd'hui, on parle des entreprises à mission, de la loi Pacte.
À mon sens, la question n'est donc pas le rôle de l’entreprise dans la société, mais le pourquoi de son éternel retour – comme s’il était impossible de tenir une position dans le temps. La question se pose donc : comment faire perdurer l’engagement d’une entreprise qui se veut socialement responsable ?
Ma conviction là-dessus est très forte : si l’on veut une entreprise à mission qui dure, il faut ancrer les choses dans sa façon de prendre les décisions. Par exemple, faire entrer des représentants de la société civile dans sa gouvernance – comme on l’a fait avec les administrateurs salariés il y a quelques années, ce qui alors n’allait pas de soi mais semble évident aujourd’hui. À mon sens, c'est le point clé qui détermine la vision à long-terme du rôle de son entreprise et de son impact.

Ma conviction est très forte : si l’on veut une entreprise à mission qui dure, il faut ancrer les choses dans sa façon de prendre les décisions.
Autre élément, l’alignement entre le discours des entreprises et la réalité. Ce qu’on attend par exemple des dirigeants, notamment de la direction générale, et ses objectifs extra-financiers. De mon point de vue, dans une société qui se dirait à mission, la rémunération variable des dirigeants devrait être reliée à des objectifs extra financiers. C’est une dimension fondamentale.
Quant à la notion de raison d'être telle que portée par la loi Pacte, elle me semble à la fois importante et insuffisante. Parce qu’on ne peut pas produire sa raison d'être sur le coin de table d'un comité de direction ou d’un comité exécutif. Une entreprise à mission devrait construire sa raison d'être, en toute transparence, en association avec ses parties prenantes. Elle devrait pouvoir en rendre compte. Ce que nous avons fait de notre côté avec une démarche inédite de consultation de nos parties prenantes.
Parlons des enjeux RH : comment travaillez-vous l’engagement collaborateurs ? Notamment auprès de la jeune génération ?
C'est une question majeure. Parce que nous sommes un métier de services, nous recrutons chaque année – et cette année encore, malgré la crise – plusieurs centaines de nouveaux collaborateurs et pour une large partie, des jeunes. Et sans être réducteur et sans faire de généralités, on sent chez eux quelques attentes nouvelles.
La première, c'est un alignement avec la dimension de valeurs. Nous essayons d’aligner le dire et le faire, de trouver des modalités qui leur permettent de prendre part à l’engagement de leur entreprise. Par exemple, pendant la crise, nous avons mis en place une cellule pour écouter les sociétaires les plus en difficulté, sur la base du volontariat. Et ce volontariat a très bien fonctionné, aussi bien auprès de nos collaborateurs les plus expérimentés, que des plus jeunes.
Deuxième élément, la qualité de leur vie d'équipe et l'attente managériale. Les nouveaux collaborateurs souhaitent un management qui laisse de la place à l'autonomie. Mais l'autonomie, ce n’est pas l'indépendance : il y a bien une attente de cadre, de transmission, de partage. Un enrichissement collectif, plutôt qu’un management descendant. C’est un mouvement que nous accompagnons, en sensibilisant toute la ligne managériale sur ces nouvelles pratiques.
Et la troisième attente, dont je ne saurais finalement dire si elle est exacerbée chez une génération plutôt qu’une autre, c’est celle d'un meilleur équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Ou, pour le dire autrement, que le cadre du travail n’empêche pas une souplesse de bon aloi. C’est ce que le télétravail met aujourd’hui en lumière.
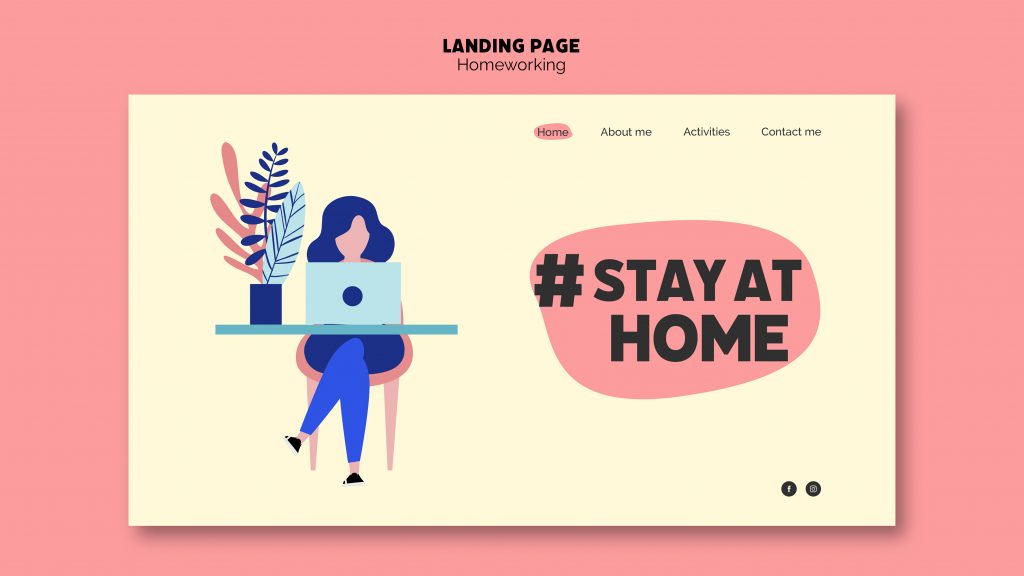
C’est là un enjeu très important, d’organisation du travail mais aussi d'attractivité et de fidélité des jeunes salariés. Car une chose est de les faire venir, une autre est de les retenir. La Macif est historiquement une entreprise où l’on fait carrière. Nos sociétaires nous sont fidèles, parce que nos collaborateurs transmettent leur passion dans la relation. Pour nous, il est essentiel que nos collaborateurs trouvent un cadre épanouissant à la Macif, mais aussi des perspectives de parcours.
L'un des marqueurs de la crise, c'est aussi l'accélération des mutations numériques, tant au niveau des usages clients que, justement, au niveau de l'organisation des entreprises. Comment s’incarnent-elles à la Macif, tant sur l'expérience client que sur l'excellence opérationnelle ?
Pendant la crise, nous avons fait face à deux attentes client, a priori contradictoires mais qui en réalité correspondent bien à l'évolution des canaux.
Une attente de réactivité, exacerbée par la situation mais aussi par la propagation de standards que les consommateurs vivent sur les plateformes digitales comme Netflix ou Amazon… Une fluidité dans l’expérience client, dont l’exigence se répand, qu’on le veuille ou non, à d’autres secteurs. Nous n’avons pas attendu la crise pour anticiper ces questions et avons depuis plusieurs années, fortement investi pour développer la souscription et la gestion de sinistre à distance par exemple.
Pour autant, on ne peut pas faire que du digital. C'est particulièrement vrai dans le métier d'assureur. Même s’il semble de prime abord assez administratif, notre service est à forte intensité émotionnelle et humaine. C’est là le deuxième enseignement de la crise : nos sociétaires, même s’ils passent par le digital, sont désireux d'avoir un contact complémentaire, téléphonique ou physique, dans 90% des cas. Et ce n'est pas qu'une question de génération ! C’est pourquoi nous recherchons la complémentarité des canaux, avec une forte dimension d’accompagnement humain. Le tout-digital doit être une faculté, mais ne peut pas être la seule.
Je ne crois pas pour notre secteur à un « grand soir » où 50% des effectifs auraient disparu dans trois ans, parce que tout sera dématérialisé. La question de l'excellence opérationnelle n’est pas tant la suppression de postes ou la diminution en intensité humaine des opérations, que celle de la bonne complétude des canaux. Et cela constitue d’énormes enjeux informatiques, de formation. Ça veut dire plus de polyvalence chez les salariés, des compétences accrues et la capacité à être accompagné par le digital.
Je ne crois pas pour notre secteur à un « grand soir » où 50% des effectifs auraient disparu dans trois ans, parce que tout sera dématérialisé.
Prenons l’exemple de Shift, qui est pour moi l'une des plus belles réussites de l'intelligence artificielle dans le secteur de l'assurance. Ce que fait cette entreprise française dans la lutte anti-fraude ne remplace pas le travail des gestionnaires mais augmente leurs capacités, en leur offrant des outils d'analyse que seuls, ils ne pourraient pas avoir. La valeur ajoutée d'intervention, d'analyse et d’action demeure bel et bien dans les mains du gestionnaire.
L’assurance est un métier de données. Quel regard portez-vous sur leur disponibilité et leur exploitation massive, notamment via l’intelligence artificielle ? Le visage du secteur va-t-il drastiquement changer ? Le principe de mutualisation du risque pourrait-il remis en cause ? Comment vous préparez-vous à l’arrivée de nouveaux entrants (InsurTech, GAFAM, etc.) ?
Sur le principe de mutualisation, il y a un vrai risque de destruction par excès de personnalisation et donc, un risque sur l'accessibilité de l'assurance. Prenez par exemple le marché anglais, qui a poussé très loin le niveau de personnalisation : on constate que c’est finalement destructeur de valeur. Parce que ça crée un mécanisme avec de nombreux intermédiaires, de fortes rotations de portefeuilles et vous finissez par payer votre assurance plus chère, même si elle est personnalisée. À l’inverse, la France, où l'assurance est très mutualisée, est le pays d’Europe où l'assurance auto est la moins chère.

Concernant les nouveaux entrants, tout sera question d'ordre et de séquence. Ce que je crois, c’est que dans un premier temps, leur offensive portera sur le développement d’assurances relativement affinitaires. Par exemple en traitant des segments de population plus sensibles à la dimension digitale, comme ce que fait Alan.
Est-ce que cela ira au-delà ? Je ne saurais le dire, mais si j'étais à leur place, c'est plutôt là que j’irais. En réalité, je vois plus le courtage se développer car derrière la question de l’IA, il y a la notion de la qualité de la relation client. Mais quoi qu’il en soit, pour ces nouveaux acteurs, startups ou GAFAM, il y aura un énorme prérequis sur lequel nous, assureurs installés et en particulier mutualistes, devrons insister : la confiance.
Alors bien sûr, il y aura toujours une part de technophiles early-adopters. Pour autant, les enquêtes d'opinion montrent l’extrême sensibilité de la population française sur l’usage des données personnelles, notamment par les grands acteurs de la technologie.
Nous, acteurs de confiance, devons apporter et exprimer toutes les cautions nécessaires en matière d'utilisation éthique des données que l’on nous confie. On ne les surexploite pas, on ne les vend pas, on les protège en toute sécurité. Et si un sociétaire nous accorde cette confiance-là, il doit obtenir quelque chose en retour – qui n’est pas que son tarif.
Face aux acteurs de la Tech, je crois que la bonne réponse est l'expression d'un projet de valeurs qui respecte les sociétaires au sein d’une communauté. Ce bouclier-là peut être très fort – plus, en tout cas, que le réflexe qui consisterait à chercher à les copier. Ainsi que l’excellence et la différenciation de notre relation client. Quand on regarde les secteurs qui se sont fait disrupter, ils l’ont tous été sur une base technologique certes, mais aussi sur la faiblesse ressentie à un moment donné de leur relation client. Une mutuelle doit constamment prouver qu’elle est meilleure en la matière.
<< Résolutions : « De la défiance à la care brand »
A suivre : Les Défricheurs, les meilleures initiatives des acteur.e.s du changement >>






